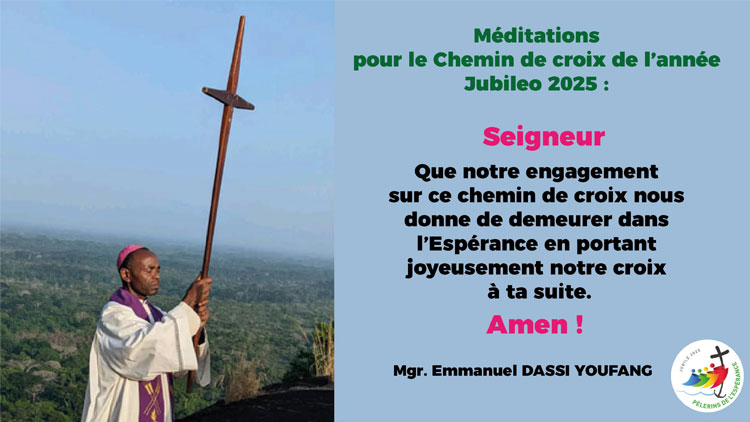Le chemin de croix des origines à nos jours
Le Chemin de Croix, également connu sous le nom de Via Dolorosa, est une pratique dévotionnelle chrétienne qui retrace les étapes de la Passion du Christ. Depuis les premiers siècles, des pèlerins ont parcouru les rues de Jérusalem pour suivre les traces de Jésus jusqu’au Golgotha. Cette tradition s’est perpétuée et adaptée au fil des siècles, devenant un élément central de la spiritualité chrétienne.
Des origines à Jérusalem
Dès le IVe siècle, des chrétiens ont entrepris des pèlerinages à Jérusalem pour commémorer la Passion du Christ. Ils suivaient un itinéraire allant du palais de Pilate jusqu’au lieu de la crucifixion, le Golgotha. Ce parcours, connu sous le nom de Via Dolorosa, est devenu un lieu de prière et de méditation pour les fidèles.
L’influence des Franciscains
Au XIIIe siècle, les Franciscains, devenus gardiens des Lieux Saints, ont structuré le Chemin de Croix en y ajoutant des stations représentant des moments clés de la Passion. Cette initiative visait à permettre aux fidèles, même ceux ne pouvant se rendre en Terre Sainte, de vivre spirituellement la Passion du Christ.
L’établissement des 14 stations
Au XVIIIe siècle, le pape Clément XII a fixé le nombre de stations à quatorze, une structure qui est restée largement en usage jusqu’à aujourd’hui. Ces stations incluent des événements bibliques, comme la condamnation de Jésus, ainsi que des éléments issus de la tradition chrétienne, tels que la rencontre avec Véronique.
Une dévotion vivante
Le Chemin de Croix est particulièrement pratiqué pendant le Carême, notamment le Vendredi saint. Il est souvent représenté par des tableaux ou des sculptures dans les églises, permettant aux fidèles de méditer sur la souffrance et la mort de Jésus. Cette pratique invite à la réflexion sur la compassion, la justice et le sacrifice.
Ainsi, le Chemin de Croix demeure une expression profonde de la foi chrétienne, reliant les croyants à la Passion du Christ à travers les siècles.
L’Église, tout en donnant sa reconnaissance nécessaire à cette dévotion, n’en fit jamais une liturgie proprement dite. Elle fait partie de ce que les «instructions» pontificales appellent les «pia exercitia», les «pieux exercices». Ce qui caractérise ces «pieux exercices», c’est la liberté de leur organisation, à la condition qu’ils soient approuvés dans le sens même de l’Église.
Depuis 1958 et la construction à Lourdes d’un chemin de croix de 15 stations, l’habitude s’est répandue de le terminer, dans l’espérance de la Résurrection du Christ. Jean-Paul II termine ainsi les Chemins de Croix du Colisée à Rome. Le même pape, tout en conservant le nombre de 14 stations, en modifia la liste depuis plusieurs années, de manière à supprimer celles privées de référence biblique précise, c’est-à-dire les 3 chûtes de Jésus, sa rencontre avec sa Mère, celle avec Véronique. Il les remplaça par celles de Jésus au Jardin des Oliviers, le reniement de Pierre et la promesse du paradis au bon larron. Néanmoins, le chemin de croix traditionnel reste le plus suivi dans l’Église.
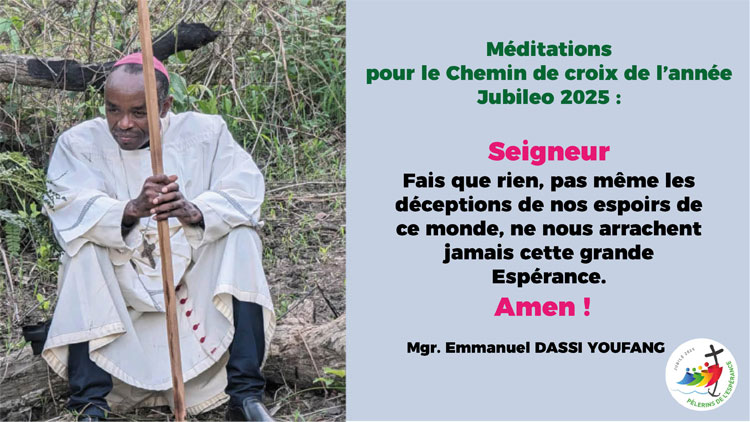
Par Mgr Emmanuel DASSI YOUFANG